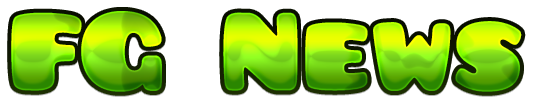inquiétude normale qu’on doit avoir. Moi, je plain ceux qui n’en ont pas. Mesdames, messieurs, il riait pour les autres mais son cœur lui criait en silence. En 1982, Louis de Funesse tourne Le gendarme et les gendarmettes, un rôle bondissant, vif, exigeant. Mais derrière chaque éclatan, il cache un secret. Son cœur est à bout.
Ce n’est pas sur une grande scène, ni au sommet d’un festival qu’il s’éteint, mais dans la discrétion d’un hôpital à Nant. Le 27 janvier 1983, aucun projecteur, aucun applaudissement, juste le silence d’une chambre dans l’aile cardiologique de la clinique du Roseray. À 68 ans, il meurt d’un infarctus massif, son trè.
Un adieu foudroyant quelques mois seulement après avoir donné sa dernière performance. L’homme aux mimiques inoubliables, adulé de millions de spectateurs, quitte ce monde sans bruit. Un comédien de génie rattrapé par ce qu’il avait toujours tenté de dissimuler sa fragilité. Louis Germain David de Funesse de Galarza naî le 31 juillet 1914 à Courbevois dans une famille d’origine espagnole.
Son père avocat de formation fuit la guerre civile en Espagne pour s’installer en France. La jeunesse de Louis est marquée par une grande discrétion, un caractère réservé et un goût précoce pour le dessin et la musique. Avant même de rêver de cinéma, il étudie le piano au conservatoire et gagne sa vie comme accompagnateur dans des cabarets parisiens.
C’est seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale que sa trajectoire artistique démarre réellement. En 1945, il obtient ses premiers rôles au théâtre et au cinéma. Souvent des apparitions furtives dans des films de série B. Pendant plus de 10x ans, il accumule les petits rôles : liftier, serveurs, clients, voisin, sans jamais décrocher la vedette.
Son visage devient familier mais son nom reste inconnu du grand public. Il faut attendre les années 1960 pour qu’une première reconnaissance émerge. En 1964, le succès du film Le gendarme de Saint- Tropé le propulse sous sommet. Son interprétation du maréchal des logies Cruchotud séduit immédiatement. L’énergie explosive, les grimaces millimétrées, la diction précipitée, tout devient signature.
Le film cartonne avec plus de 7 millions d’entrées et inaugure une saga de six volets devenus cultees. La même année, il enchaîne avec le cornion de Gérard Oui, puis en 1966 avec la Grande Vadrouille, toujours au côté de Bourville. Ce dernier film bat des records absolus en France avec plus de 17 millions d’entrées.
Un chiffre inégalé jusqu’en 1997. De Funesse devient alors l’un des acteurs les plus rentables et les plus aimés du cinéma français. Dans les années suivantes, il enchaîne les succès avec des titres comme Fantomas 1964-167, l’homme Orchestre 1970, l’aile ou la cuisse 1976 ou encore la Zizanie 1978. Souvent sous la direction de Jean- Girot ou Gérard, il incarne systématiquement des personnages exaspérés, colériques, au nerf fragile, mais à la gestuelle irrésistible.
Sa capacité à jouer sur la rapidité, l’absurde, l’excès, devient un art à part entière. Aucun autre comédien n’atteint une telle maîtrise du comique de répétition, ni un tel impact visuel en si peu de temps à l’écran. Malgré son immense popularité, Louis Funes reste un homme de peu de mots. Rarement interviewé, fuyant les mondanités, il vit paisiblement avec sa femme Jeanne à Saint-Claur Loire, dans le château de Clermont.
Passionné de botanique, il consacre ses loisirs à son jardin loin du tumulte parisien. Il est décoré chevalier de la Légion d’honneur en 1973, preuve de la reconnaissance institutionnelle pour son apport à la culture française. À la fin des années 1970, les critiques commencent à s’interroger sur la répétitivité de ces rôles, mais le public lui ne faiblit pas.
Chaque sortie de film avec son nom au générique assure des millions d’entrées. En 1980, il reçoit un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Une consécration tardive mais chaleureusement saluée par la profession. Louis de Funess qui n’a jamais joué dans un film américain ni tenté de conquérir l’étranger reste pourtant un phénomène international.
Ces films sont traduits et diffusés dans plus de 30 pays. Pourtant, c’est en France qu’il atteint ce statut rare de comédien devenu patrimoine national incarnant à lui seul une époque de rire collectif, de cinéma populaires et d’héritage comiques sans égal. Le rire de Louis Funess, aussi contagieux soit-il, a longtemps dissimulé une réalité bien plus sombre.
Dès le milieu des années 1970, l’image du comique national commence à se fissurer, non pas à cause de scandal public, mais sous le poids de l’épuisement physique et des pressions du succès. En 1975, alors qu’il est au sommet de sa carrière, une première alerte sérieuse survient en pleine répétition pour la pièce le crocodile.
Il est victime d’un infarctus. Le projet est immédiatement abandonné. Le comédien affaibli se voit contraint de s’éloigner de la scène pendant plusieurs mois. La presse de l’époque s’inquiète. De funesse, pourra-t-il revenir ? Titre le Figaro. Son absence crée un vide dans le paysage comique français et ses fans craignent de ne plus jamais le revoir.
Contre toute attente, après une convalescence prudente, il revient au cinéma dès l’année suivante avec l’aile ou la cuisse au côté de Coluche. Mais ce retour s’accompagne d’une surveillance médicale stricte. Les assureurs refusent désormais de couvrir certains de ces tournages sans garantie solide. Les réalisateurs doivent adapter les scénarios.
Moins de cascades, moins d’efforts physiques et plus de plans fixes. Derrière la caméra, tout est orchestré pour masquer la vulnérabilité croissante de l’acteur. Un autre choc surgit en 1978 lorsqu’un deuxième infarctus le frappe. Cette fois, le diagnostic est sévère, l’artère coronaire est fragilisée. Le moindre excès pourrait être fatal.
Louis Funes prend alors la décision de ralentir. Il refuse plusieurs rôles dont celui d’un prêtre dans une comédie dramatique italienne estimant qu’il ne pourrait pas tenir le rythme du tournage. Pourtant, il continue de tourner des films conscient que chaque projet pourrait être le dernier. Malgré sa popularité inédranlable, De Funesse n’échappe pas à certaines critiques.
Au tournant des années 1980, une frange de la presse lui reproche de faire toujours la même chose, de n’évoluer ni dans le ton ni dans le registre. Telérerama publie en 1981 un article intitulé “L’homme qui ne rit plus” dénonçant la mécanique trop huilée de ses rôles. Le comédien n’y répond pas publiquement, fidèle à sa discrétion légendaire, mais les proches racontent qu’il a été profondément blessé.
Il ne comprenait pas qu’on puisse lui en vouloir de rester fidèle à son style, à ce que le public attendait, confie plus tard son fils Olivier. Autre paradoxe, l’homme, aussi exubérant à l’écran, était d’une timidité maladive dans la vie réelle. Il fuyait les interviews, refusait les plateaux télé et les mondanités.
Lorsqu’il recevait son César d’honneur en 1980, il monta sur scène avec émotion, mais ne prononça qu’un discours bref, presque murmurant. Ce contraste a souvent été source de malentendu. Certains collègues le trouvaient distant, froid, voire hauteint. En réalité, il redoutaient la foule, la surexposition et vivait dans la peur permanente d’un malaise cardiaque en public.
Sa santé mentale, bien que rarement évoquée, a été fragilisée par cette tension constante. Dans une interview confidentielle publié à titre poste par le Parisien, un proche témoigne. Louis avait peur de mourir sur scène, mais il avait encore plus peur de décevoir le public. Ce dilemme tragique l’a poursuivi jusqu’au bout.
Dans les dernières années, une fracture s’a même installé avec certains producteurs historiques. En 1982, les négociations pour un éventuel nouveau film avec Gérard Ori tourne court. De Funesse, exigeant sur les conditions de tournage, refuse tout déplacement à l’étranger, ce qui complique les projets ambitieux.
Cette rupture artistique marque la fin d’une époque. Le twist le plus amer survient après le tournage de Le gendarme et les gendarmettes. Bien que le film se veuille léger, drôle, presque naïf, le plateau est empreint d’une ambiance lourde. L’acteur apparaîtri, fatigué, distant. Certaines scènes sont tournées avec des doublures et les dialogues sont raccourcis pour ménager ses forces.
À la sortie du film, une partie du public se réjouit, mais une autre sent que quelque chose s’est éteint. Louis Funess lui-même confie à un technicien : “Ce sera peut-être la dernière fois qu’on me verra rire.” Et il avait raison. Dans les dernières années de sa vie, Louis de Funesse s’éloigne progressivement de la scène médiatique.
Fatigué par les tournages, affaibli par ses deux infarctus successifs, il choisit de se retirer à la campagne dans sa demeure du château de Clermont situé à Lecélier, près de Nant. C’est là qu’il trouve un semblant de paix. entouré de son épouse Jeanne, avec qui il partage une vie discrète depuis plus de 40 ans.
Le château entouré de verdure et de silence devient son refuge. À partir de 1980, il réduit considérablement ses apparitions publiques. Il refuse systématiquement les plateaux télévisés, décline les interviews et ne se rend plus au festival. Quand les journalistes tentaient d’obtenir un commentaire, c’est souvent son fils Olivier ou son épouse qui répond.
Selon un témoignage rapporté par Paris Match, il aurait déclaré à son entourage : “J’ai donné toute mon énergie au public, maintenant j’en garde un peu pour moi.” Une phrase qui résume le retrait volontaire d’un homme longtemps consumé par les exigences du métier. Physiquement, les signes d’un épuisement chronique deviennent visibles.
Il perd du poids, marche plus lentement et reste de longues heures assis dans son jardin, contemplant les rosiers qu’il soigne avec une extrême délicatesse. Passionné de botanique, il consacre ses journées à cultiver son potager et à lire des ouvrages spécialisés. Son épouse confirme dans une interview donnée en 1984, Louis ne parlait plus de cinéma, il parlait de ses plantes, de ses fleurs.
Il avait besoin de calme. Sur le plan médical, les cardiologues l’encourageaient à arrêter définitivement les tournages. Mais en 1981, il accepte malgré tout de reprendre le rôle du maréchel Cruchotud pour un ultime volet des aventures du gendarme. Le tournage de le gendarme et les gendarmtes est difficile.
Le rythme est allégé. Les scènes sont minutieusement chronométrées pour éviter tout effort superf. Selon le chef opérateur du film cité par le monde, Louis de Funesse aurait parfois eu besoin de s’allonger entre deux prises, respirant avec difficulté, mais refusant d’abandonner. Il voulait finir ce film coûte que coûte.
À cette époque, il reçoit peu de visiteurs, à l’exception de sa famille proche et de quelques amis fidèles. L’acteur Michel Galabru, son complice à l’écran, viendra le voir une dernière fois fin 1982. Dans une autre vue accordée bien plus tard, Galabru confira : “Je ne l’ai jamais vu aussi calme comme s’il savait.
Il m’a serré la main longuement. Il ne parlait plus du futur, une ambiance pesante, empreinte d’une lucidité silencieuse. Louis de Funess ne laisse aucune autobiographie, ni lettre ouverte, ni testament médiatisé. Il détestait l’idée de spectacle de fin de vie, comme il l’a un jour confié à un journaliste de France soir.
Ces derniers mois sont donc marqués par une discrétion extrême, presque un effacement progressif. Même son entourage professionnel n’était pas pleinement informé de l’état de sa santé. L’actrice qui jouait à ses côtés dans le gendarme et les gendarmettes dira plus tard il plaisantait encore mais il avait le regard d’un homme loin. La France entière continue de rire devant ses films mais lui s’éteint lentement à l’écart du monde comme un comédien qui quitte la scène sans saluer.
Le 26 janvier 1983 au soir, il regarde la télévision avec son épouse. Un film d’époque selon le témoignage de Jeanne. Puis il se couche comme à l’accoutumé sans alerte particulière. Quelques heures plus tard, au petit matin, il est victime d’une ultime crise cardiaque. Le rideau allait tomber définitivement. Le 27 janvier 1983 à l’aube, une ambulance traverse les routes encore désertes de la campagne Nantase.
À son bord, Louis de Funesse, inconscient, transporté d’urgence depuis le château de Clermont jusqu’à la clinique la Roserayie à Nant. Selon les archives du journal de Nant, l’appel au Samu a été passé peu après 6h du matin par son épouse, affolie de ne plus entendre sa respiration. Les secours mettent une vingtaine de minutes à arriver sur place. Trop tard.
À son arrivée à la clinique, le diagnostic est sans appel. Infarctus massif, arrêt cardiaque. Les tentatives de réanimation échoue. Louis de Funesse est officiellement déclaré mort à 7h20. Aucun médecin n’a pu inverser le processus. Ce fut son troisème infarctus en moins de 10 ans. Le dernier fatal. La chambre est froide, sans bruit.
Aucun plateau de tournage, aucune caméra, aucune répétition. Simplement le silence clinique d’un service de cardiologie. C’est là que s’arrête la trajectoire de celui que la France avait adopté comme le visage du rire populaire. Ironie tragique, l’homme qui avait redonner vie à tant de personnages meurt loin des projecteurs dans un anonymat médical presque dérangeant.
Son épouse Jeanne est à ses côtés. Elle témoigne plus tard dans une rare déclaration. Il ne s’est pas plaint. Il s’est endormi doucement comme s’il partait en paix. Le médecin de garde interrogé par France Tro Nant confirmera que la mort a été rapide. sans souffrance apparente, aucune dernière parole connue, aucun adieu solennel, juste l’extinction silencieuse d’un corps trop usé.
Dans les heures qui suivent, la nouvelle circule d’abord dans les cercles familiaux. Le fils aîné Olivier de Funess, ancien acteur devenu pilote de ligne, arrive dans la matinée. Ce n’est qu’en début d’après-midi que l’information est confirmée à l’AFP. Les radios interrompent leur programme habituel. Sur RTL, un court flash annonce : “Louis de Funesse est décédé ce matin à Nant.
Le cinéma français perd l’un de ses plus grands comiques. Les premières réactions sont teintées de choc. Le public ne savait pas qu’il était encore malade. Quelques mois plus tôt, il souriait encore à l’écran dans le gendarme et les gendarmetes. Une comédie légère, colorée où il tenait son rôle avec brio malgré la fatigue. Personne ne pouvait imaginer que ce film serait son adieu.
Le contraste entre l’énergie du personnage et la faiblesse de l’homme réel n’a jamais été aussi criant. Ces obsèques sont organisés dans la plus stricte intimité selon ses souhaits. Pas de caméra, pas de déclaration officielle, pas de cortège médiatique. Le 29 janvier, il est inumé au cimetière du Sélier dans le parc même du château où il a passé ces dernières années.
Sa tombée simple, horné de fleurs naturelles sans exubérance. C’est là, dans ce coin paisible de Loire Atlantique, que repose celui dont le rire raisonne encore dans les foyers français. Un départ à l’image de sa vie privée, pudique, discret, presque effacé, mais d’une puissance silencieuse inoubliable.
La mort de Louis de Funesse, bien que discrète, provoque un rat de maris émotionnel en France. Pendant des jours, les chaînes de télévision rediffusent ces films. Les journaux titrent “La France a perdu son rire, le Parisien” ou encore le silence après la tempête comique. Libération. Le public, toute génération confondue, pleure un homme qu’il considérait comme un membre de la famille.
Son héritage cinématographique est immense. Plus de 140 films, des millions de spectateurs, une influence durable sur l’humour français. En, un musée Louis de Funesse ouvre ses portes à Saint-Raphaël, retraçant son parcours à travers objets, affiches et archives inédites. Les droits d’auteur de ces œuvres sont gérés par ses enfants, notamment Olivier, qui veille à la préservation de l’image de son père.
Mais au-delà des chiffres, c’est une présence qui manque. Chaque rediffusion soulève la même question. Comment un homme si drôle pouvait-il porter autant de douleurs en silence ? Louis de Funesse n’a pas seulement fait rire, il a enseigné par contraste la beauté de l’humilité. Et peut-être qu’au fond, le comédien le plus bruyant du cinéma français n’aspirait qu’à une chose : qu’on le laisse partir en paix. M.