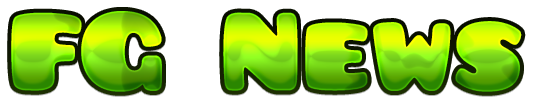Mais la beauté ça n’a pas d’importance de toute Mesdames messieurs, le 1er octobre 2018 Charles Aznavour est retrouvé sans vie seul dans sa baignoire à l’âge de 94 ans. Aucun médecin, aucun proche, aucun dernier mot, juste le silence. Ce n’était pas dans un hôpital ni dans une maison de retraite, mais chez lui à Maè dans le sud paisible de la France.
Un homme que le monde entier avait applaudi, honoré, décoré, s’est éteint dans une solitude presque cruelle. Aucun journal ne l’avait annoncé malade. Aucun signe avant-coureur ne laissait présagir une fin si brutale. Comment une téléicone encore active quelques jours avant au Japon a-t-elle pu disparaître de cette manière ? Est-ce la fatalité de la vieillesse ou le poids d’une vie passée sous les projecteurs qu’il a rattrapé ? Aujourd’hui, nous plongeons dans les ultimes instants les lumières et les ombres de Charles
Aznavour. Charles Aznavour de son vrai nom Chan Vaginag Aznavourian voit le jour le 22 mai 1924 à Paris dans une famille arménienne ayant fui les persécutions ottomanes. Son père Micha Aznavourian est bariton et sa mère Knar Bagdassarian actrice. Dès l’enfance, le jeune Charles baigne dans un univers artistique et apprend rapidement que la scène peut être une terre d’accueil pour ceux que l’histoire a bousculé.
Il débute très tôt dans le monde du spectacle, quittant l’école à l’âge de 9 ans pour se consacrer entièrement à sa passion. Dans les années 1940, il chante dans des cabarets parisiens et survit de petits rôles au théâtre. Mais c’est sa rencontre avec Eddith Piaf dans l’immédiate après-guerre qui change tout.
Séduit par sa plume et sa voix singulière, Piaf l’emmène avec elle en tournée. Elle devient son mentor et l’introduit au grand circuit de la chanson française. Dans les années 1950, Aznavour commence à se faire un nom en solo. D’abord critiqué pour sa voix nazillarde et son allure peu conventionnelle, il s’impose peu à peu comme un parolier horspaire, un interprète sensible et un compteur d’émotion universelle.
En 1956, Survie devient son premier grand succès. Suivent ensuite des titres devenus classiques, la Bohème. Hier encore, emmenez-moi, je me voyais déjà, chacun explorant les regrets, les amours perdus, le temps qui passe. Son ascension est fulgurante. Dans les années 1960 et 1970, il multiplie les tournées internationales.
Il se produit à Carnegi Hall à New York, au Royal Abert Hall à Londres et conquière un public au-delà des frontiens francophones. Il enregistre dans plusieurs langues anglais, espagnol, italien, allemand, arménien devenant un ambassadeur mondial de la chanson française. Ces albums se vendent par millions, plus de 100 millions d’exemplaires au total et il composent pour les plus grands, de Lisa Minelli à Bin Crosby.
Mais Aznavour ne se limite pas à la musique. Il mène en parallèle une carrière d’apteur avec plus de 60 films à son actif. On le voit notamment dans tiré sur le pianiste 1960 de François Truffo qui révèle son talent dramatique. Il incarne souvent des personnages tourmentés, solitaires, proches de ses propres textes.
Reconnu par la critique comme par le public, il reçoit d’innombrables distinctions. Officier de la Légion d’honneur, commandeur des arts et des lettres, étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2004, CNN le désigne comme le plus grand chanteur de variété du siècle devant Frankck Sinatra et Elvis Presley. Selon un sondage mondial. Dans les années 2000 et 2010, alors que beaucoup auraient pris leur retraite, Aznavou continue à écrire, enregistrer et à monter sur scène.
Il chante encore à guichet fermé à plus de 90 ans, refusant de céder à l’âge. Il dit un jour, “Tant que je peux marcher, je peux chanter.” Son énergie fascine, sa longévité inspire. À 94 ans, il prépare encore une tournée mondiale comme s’il défiait le temps. Artiste total, homme de lettre, citoyen engagé, Charles Aznavour incarne une France ouverte, humaniste et profondément sensible.
Sa vie est celle d’un homme qui n’a jamais cessé de croire en la beauté des mots et en la puissance de la scène. Charles Aznavour n’a pas connu une ascension linéaire. Avant d’atteindre la gloire, il a dû affronter critiques virulentes, rejets, scandales financiers et luttes internes. Ces épreuves forgèrent le personnage, mais les serrent aussi des cicatrices.
Dès ses débuts, il est moqué et ridiculisé. On le traite de lait, de trop petit, avec une voix trop nazillard ou stable. Un critique du monde écrivit qu’il écrit d’excellentes chansons mais les interprètent bien mal. Une attaque publique contre sa légitimité comme interprète. Ces jugements ne furent pas anecdotiques, mais structurant d’un climat de défiance contre un artiste issu de l’immigration.
Edit Piaf, qu’il considérait comme mentor lui imposa une opération esthétique, un petit travail sur le nez pour rendre son apparence plus acceptable sur scène. Paradoxalement, Piaf lui dira après : “Je t’aimais mieux avant.” Cette dualité entre soutien et pression révèle la tension permanente entre reconnaissance artistique et conformisme esthétique.
La route vers la reconnaissance fut lente. Aznavour composa pour d’autres longtemps avant de s’imposer lui-même. Même lorsqu’il commença à se produire en solo, il pénète à convaincre. Ses débuts au musical ne faisaient pas sale comble. Son marque vocal était une source de dérision dans les médias. Un tournant se produisit à la fin des années 1950.
Une représentation au Moulin Rouge puis à l’Olympia marque la bascule vers une reconnaissance publique. Mais cela n’effaça pas les cicatrices. Ses traits, sa voix rocailleuse et son physique frê restèrent pointé du doigt jusqu’à ce qu’on les adopte comme empreinte artistique. Sur le plan personnel, il connut plusieurs épreuves.
Il divorça à deux reprises avant de trouver la stabilité avec Ull Torcelle. Un des coups les plus durs fut la mort tragique de son fils Patrick à l’âge de 25 ans en 1976. Le chagrin familial l’affecta profondément, mais il répondit à la douleur par la musique en continuant de composer et de chanter. Sur le plan légal, Aznavour affaire à la justice française.
En 1972, il fut impliqué dans une affaire de fraude fiscale. Accusé d’exil fiscal, il reçut des poursuites. Un mandat d’arrêt international fut émis alors qu’il se trouvait aux États-Unis. En 1979, il fut condamné à 3 millions de francs et à une année de prison avec surcis pour évasion fiscale. Finalement, un nonlieu fut prononcé en 1980 closant officiellement ce chapitre.
Cette affaire jeta une ombre sur sa réputation. Son image d’artiste sensible fut mise en balance avec celle d’un homme puissant au lien financier complexe. Artistiquement, il prit aussi des risques. Il aborda des thèmes tabou : la sexualité masculine, la vieillesse, l’ennui, l’homosexualité. Son titre, comme ils disent, 1972, traitant de l’homosexualité avec compassion, resta audacieux pour l’époque.
Sa balade, après l’amour évoquant l’intimité post-coitale, fut à l’époque censurée. Dans ces chansons, il osa nommer merde ou piss, refusant d’édulcorer ses mots. Sa liberté de ton effrayer ceux qui voulaient une chanson asceptisée. Un autre défi fut l’accès au marché anglophone. Ces paroles, profondément françaises et littéraires, perdirent beaucoup de leur intensité dans les traductions.
Alors qu’il était acclamé en Europe, aux Amériques latines et en Asie, il ne réussit pas à percer durablement aux États-Unis. Ces obstacles façonnèrent son caractère. Azvour devint un artiste résilient, capable de métamorphoser ses faiblesses en force. Chaque critique, chaque rejet alimenta sa détermination à prouver sa valeur.
Ses épreuves rendirent d’autant plus émouvant ses succès tardifs. Elles donnaient du poids à ses textes, une vérité, une douleur authentique et elles élargirent la portée universelle de sa voix. À plus de 90-0x ans, Charles Aznavour continuait de défier le temps tandis que la plupart des artistes de sa génération s’était retiré depuis longtemps, lui persistait.
En 2018, à l’âge de 94 ans, il assurait encore des concerts à guichet fermet, notamment au Japon. Pourtant, dévièr cette activité intense, se cachait une réalité plus silencieuse, plus intime. Aznavour vivait à Mourriè, un petit village des Alpilles dans le sud de la France. Loin des projecteurs parisiens, il s’était installé dans une maison discrète entourée d’oliviers.
Il avait choisi cette région pour sa tranquillité, loin du tumulte médiatique. Bien qu’il eut une famille nombreuse, six enfants issus de plusieurs unions, il vivait seul la plupart du temps. Sa dernière compagne, Hulla Torsel, une ancienne mannequin suédoise avec qui il s’était marié en 1967, passait du temps avec lui, mais sa présence n’était pas constante, notamment lorsqu’il se reposait entre deux tournées.
Dans une de ces dernières interviews accordées à France I en mai 2018, il déclarait : “Je me sens en forme, je veux mourir sur scène, pas dans un lit.” Ces mots prononcés quelques mois avant sa mort prennent aujourd’hui une résonance particulière. Il y ait également qu’il n’avait jamais aussi bien chanté.
Pourtant, ses proches avaient remarqué une certaine fatigue. Il avait annulé plusieurs concerts en avril à cause d’une fracture du bras d à une chute et sa voix, autrefois puissante, devenait plus fragile. Malgré cela, Aznavour refusait d’évoquer la retraite. Il planifiait encore des tournées internationales et écrivait régulièrement de nouvelles chansons.
Il avait même évoqué un album en arménien et un autre en anglais. Ce refus de s’arrêter traduisait moins une ambition dévorante qu’un besoin viscéral de rester en mouvement. Dans son entourage artistique, beaucoup le disaient infatigable. D’autres, plus inquiets, parlaient d’un homme incapable d’accepter le silence.
À la fin de sa vie, il apparaissait de plus en plus rarement en public hors scène. Il n’assistait presque plus aux cérémonies ou gala. Lors des obsèques de Johnny Alid en 2017, il avait décliné l’invitation officielle, déclarant simplement que la mort ne se pleure pas en public. Cette distance volontaire traduisait une forme de retrait, peut-être aussi une lassitude face à un monde qu’il jugeait de plus en plus éloigné de ses valeurs.
Des proches ont confié après sa disparition que Charles Aznavour s’isolait progressivement. Il lisait beaucoup, regardait les journaux télévisés, écrivait parfois jusqu’à tard dans la nuit. Son assistant personnel dans un entretien accordé à Paris Match a évoqué un homme lucide sur sa condition qui savait que la fin approchait mais n’en parlait pas.
Il avait donné des consignes précises sur ses funérailles, notamment sur le lieu de dépôt de ses cendres. Malgré son âge avancé, aucun soin médical à domicile n’avait été mis en place de manière permanente. Il refusait les infirmiers, ne voulait pas de l’imédicaliser. Lorsqu’on lui en parlait, il éluit, disant que le corps suit tant que l’esprit est là.
Ce refus d’accepter la vulnérabilité physique faisait partie de son personnage public et de son orgueil artiste. Son dernier concert eût eu lieu le 19 septembre 2018 à Osaka. Moins de deux semaines plus tard, il s’éteignait seul dans sa maison de Mauriè. Aucune équipe médicale, aucun témoin, juste le corps d’un homme de 94 ans retrouvé sans vie dans une salle de bain silencieuse.
La fin de vie de Charlaz Navour n’a pas été une lente descente, mais une ligne droite interrompue soudainement. Une voie encore debout et puis plus rien. Pas de maladie tronique longue, pas de soin palliatif, juste un adieu sans bruit à la manière d’un rideau qui tombe sans prévenir.
Le lundi 1er octobre 2018 au matin, Charlaznavour ne répond pas aux appels. Inquiet, un membre de son personnel de maison se rend dans la résidence du chanteur à Mourriè dans les bouches du Rône. C’est là dans la salle de bain que l’on découvre le corps sans vie de l’artiste. Il est allongé dans la baignoire inerte. Aucun bruit, aucune alerte, aucun signe de lutte.
Le silence est total. La nouvelle fait rapidement le tour du pays. Selon les premières informations transmises par la gendarmerie et confirmée par le parquet de Tarascon, aucun élément suspect n’est relevé. Une autopsie est demandée pour écarter toute hypothèse criminelle, mais les conclusions sont claires. Mort naturelle dû à un arrêt cardiorespiratoire avec signe de congestion pulmonaire.
Il s’agit d’un décès brutal, probablement survenu pendant la nuit ou tôt le matin. Aucun témoin, aucun proche auprès de lui. Il est mort seul. Le lieu du décès ajoute à l’étrangeté la baignoire, un espace intime, isolé, glacial. Ce détail mentionné dans les rapports médicaux et repris par les journaux comme le Parisien ou le monde choque l’opinion.
Comment un monument national salué à l’échelle mondiale peut-il disparaître sans qu’aucune main ne lui tienne la sienne ? Sa famille est prévenue plus tard dans la journée. Ses enfants sont bouleversés. Certains, comme son fils Nicolas prendront la parole publiquement dans les jours qui suivent, visiblement encore sous le choc.
Dans les heures qui suivent la découverte du corps, la maison est bouclée. La presse arrive vite, mais les autorités et la famille demandent le respect du deuil. Des fans se rassemblent spontanément devant sa résidence. Des fleurs sont déposées, des bougies allumées. Mais aucune caméra ne filme les derniers instants de sa dépouille.
Aucun message final n’a été laissé, aucun enregistrement, aucune lettre. Azvour n’a pas eu de mot d’adieu. Sa disparition est aussi soudaine que silencieuse. Ce jour-là, il n’y avait pas de personnel médical, pas d’infirmier à domicile. Il n’y avait pas non plus de dispositif d’urgence dans la maison. L’artiste refusait depuis des années toute assistance médicale régulière.
Il se voulait indépendant jusqu’au bout. Cette volonté d’autonomie admirée par beaucoup devient ici une ombre. Elle l’a peut-être privée d’une intervention rapide. Le soir même, Emmanuel Macron salue l’un des visages les plus éclatants de la chanson française. Le président évoque une voix qui a accompagné les joies et les peines de plusieurs générations.
Mais derrière les MOS officiels, une réalité s’impose. Aznavour est mort seul dans la banalité domestique d’un matin d’octobre, loin des scènes illuminées. Ce dernier moment, froid, sans témoin, sans adieu, raisonne comme une rupture brutale. Un rideau tombe mais aucun applaudissement ne l’accompagne. Juste l’écho d’une salle vide et l’image d’un homme qui après avoir chanter l’amour et le temps s’éteint sans que personne ne le voit.
Après sa disparition, la France entière s’est figée. Le 5 octobre 2018, un hommage national est rendu aux invalides en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre arménien. Ces chansons raésonnent sous les voûtes militaires, là où reposent les grands de la République. L’émotion est palpable.
Le cercueil drapé de tricolores, les larmes de ses enfants, les silences du public, tout respire la solennité. Mais au-delà des hommages officiels, l’héritage d’Aznavour divise. Certains regrettent qu’il ait été plus célébré à l’étranger qu’en France dans ces dernières années. D’autres dénoncent l’absence d’un musée ou d’un véritable lieu de mémoire.
Son œuvre, riche de plus de 1000 chansons et de dizaines de rôles au cinéma reste intacte. Mais sa maison de Mourriè où il est mort demeure fermé, presque oublié. Ces cendres ont été déposées à Montfort Lamori dans l’intimité selon sa volonté. Aucun mausolé, aucune statue, juste une voix qui hente encore les ondes. Alors que la France s’interroge sur la manière d’honorer ses grands disparus, une question demeure.
Comment un artiste aussi universal peut-il partir sans dernier mot ? Et que restera-t-il de lui dans 100 ans ? une chanson ou un silence.