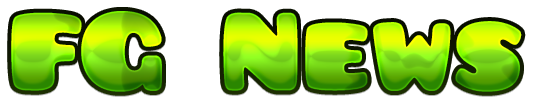Mesdames, messieurs, en 2025, une phrase de Pierre Desprog a déclenché une tempête politique. Arrachée à son contexte, recyclé par un député d’extrême droite pour justifier une déclaration controversée, cette citation a fait le tour des réseaux avant que les proches de l’humoriste ne s’indignent publiquement.
Des proches, morts en 1988 n’avaient jamais autorisé personne à utiliser ses mots comme des armes de propagande. Lui qui maniait l’humour noir comme un scalpel, moquer l’intolérance et dénoncer les dogmes, se retrouve aujourd’hui récupéré, trahi par ce qu’il pourfondait. Son décès à 48 ans, des suites d’un cancer fulgurant, avait bouleversé la France.
Il avait refusé toute cérémonie publique, juste un enregistrement audio laissé à ses proches. Et pourtant, 35 ans plus tard, le fantôme de desproches revient hanter le débat public. Ce récit retracera l’ascension d’un génie du verbe, sa disparition prématurée et la bataille postume pour défendre l’intégrité de ces mots.
Pierre des Progesses naît le 9 mai 1939 à Pentin en banlieu parisienne. Après des débuts discrets comme journaliste à l’horreur, il entre dans l’univers de l’humour presque par accident lorsqu’il rejoint le petit rapporteur en 1975. Très vite, son style caustique et érudit séduit un public à vide de s’ tire. Il devient une figure incontournable de la télévision française grâce à ses chroniques au vitriol sur les dossiers de l’écran ou la minute nécessaire de monsieur cyclopède.
Il manie les mots avec une précision chirurgicale alliant la poésie au sarcasme, la culture classique à une ironie mordante. On le cite autant que montagne ou Voltaire, mais lui préfère l’absurde à la morale. L’un de ces traits les plus marquants est son goût pour l’impertinence face aux sujets les plus sensibles : maladie, mort, religion, racisme.
Il ose tout mais toujours avec intelligence. Dans un pays encore marqué par l’héritage de mai 68, il incarne cette France qui pense et qui rit sans jamais céder à la facilité. Pourtant, malgré son succès, des Progesses restent en marge du showbsiness. Il fuit les plateaux trop lisses, se méfie de la notoriété, refuse les compromissions.
À la fois adulé et craint, il s’impose comme une conscience mordante, solitaire et insoumise. En 1987, Pierre des Proches disparaît soudainement des radars médiatiques. Ceux qui le connaissent bien devinent qu’il se retire pour des raisons graves. Atteint d’un cancer du poumon foudroyant, il décide de vivre sa maladie dans le silence le plus absolu.
Aucun communiqué. Aucune interview. Même ses amis les plus proches sont mis à distance. Pour un homme qui a passé sa vie à manier les mots, l’ironie est cruelle. Son propre corps devient l’ultime ennemi contre lequel il n’a plus de trait d’esprit à opposer. Hospitalisé à Paris, il continue néanmoins d’écrire.
Certains manuscrits, jamais publiés de son vivant, réapparaîtront bien plus tard. Le 18 avril 1988, à seulement 48 ans, il s’éteint à l’hôpital du Cremelin Bicre. Aucune cérémonie publique, aucun hommage national, juste un enregistrement audio laissé en guise d’adieux diffusé à quelques proches. Je suis désolé de vous déranger, surtout un lundi.
C’est sec, absurde, terriblement drôle. Fidèle à lui-même, des proches tournent sa mort en dérision. Mais ce silence officiel fait polémique. Pourquoi un génie pareil salué par tant d’intellectuels ne reçoit-il pas de dommage télévisé ? La télévision publique reste muette. Certains y voit une gêne persistante vis-à-vis de son humour subversif.
D’autres point le rejet du politiquement incorrect. Sa mort passe presque inaperçu dans les journaux télévisés à une époque marquée par des débats politiques tendus. Pourtant, dans les cercles littéraires et artistiques, l’émotion est immense. Renault, Bernard Pivot, Guy Bedos, François Rolin, tous saluent l’élégance et l’exigence de son travail.
Dans les mois qui suivent, ses livres se ventent massivement. Ses enregistrements sont réédités. Le public redécouvre sa lucidité prophétique. Il avait parlé du cancer, de la peur, de la mort son jamais sombré dans le patos. Il avait prévu, sans le vouloir l’époque à venir. Et c’est justement en 2024 que la mémoire de des proches ressurgit brutalement.
Lors d’un débat télévisé houleux sur l’immigration, un député d’extrême droite cite une de ces phrases les plus connues : “On peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Il l’utilise pour justifier une attaque verbale contre un adversaire politique. Le choc est immédiat. Sur les réseaux sociaux, des milliers d’internaut dénoncent l’appropriation malhonnête de ses propos.
La fille de l’humoriste, Anne Desproges, sort de son silence pour s’indigner. Mon père aurait vomi sur ce genre d’usage. Il n’a jamais cautionné la haine. Les artistes, les journalistes, les anciens camarades de scène s’emmêlent. On exhume des extraits complets de ces spectacles pour replacer la citation dans son contexte. Dans le sketch original, des proches ne justifient en rien le mépris ou la xénophobie.
Il parle au contraire de la difficulté à faire de l’humour avec ceux qui refusent la nuance. Mais le mal est fait. Le nom de déproche circule mais pas pour les bonnes raisons. Ce détournement postume soulève une onde d’indignation nationale et surtout il interroge qui possède les mots d’un mort ? Qui a le droit d’interpréter une œuvre satirique sans l’accord de son auteur ? Un débat s’ouvre bien au-delà du cas des proges.
D’autres figures comme Coluche, Guibedos ou même Charb sont aussi citées à tort et à travers dans les discours politiques. La question devient brûlante. Faut-il légiférer sur la citation publique d’artistes décédés ? Des initiatives citoyennes émergent, exigeant que les ayants droits puissent s’opposer à la récupération d’un message.
Le Conseil supérieur de l’audiovisimel est saisi mais hésite à trancher. Une chose est certaine, même dans la mort, l’humour de Pierre Desprog continue de provoquer, déranger et poser les bonnes questions. En 1988, à la mort de Pierre Desproges, aucune annonce de succession n’est faite publiquement. Il laisse derrière lui sa femme Hélène et leur fille Anne alors adolescente.
Mais aucune grande maison de production ou de gestion d’imag ne prend le relais. Pourtant son œuvre, émission, livre, enregistrement connaît un regain d’intérêt immédiat. Les ventes de ces ouvrages comme vivons heureux en attendant la mort explosent. Ces chroniques sont rediffusées à la radio, mais son patrimoine est essentiellement intellectuel, pas matériel.
Des proches n’étaient ni propriétaires de biens luxueux, ni hommes d’affaires. Il vivait simplement et n’a jamais constitué un empire financier. Les droits d’auteur de ces textes et de ses interventions audiovisuelles sont longtemps gérés discrètement par sa veuve sans réel appui juridique structuré.
Il faudra attendre les années 2000 pour qu’un éditeur comme le Seuil prenne en charge la réédition officielle de ses œuvres. Mais là encore, les droits sont morcelés. Certains passages de ces spectacles appartiennent à LINA, d’autres aux chaînes de l’époque TF1, FR3. D’autres encore n’ont jamais été contractualisé.
Cette complexité freine toute adaptation moderne de ces textes. Plusieurs tentatives d’adaptation théâtrale ou cinématographique sont refusées ou bloqué faute de clarté juridique. En 2015, à l’approche de l’anniversaire des 30 ans de sa mort, un collectif de comédiens tente de monter un spectacle hommage intitulé Rire de tout. Mais la fille de l’humoriste s’y oppose, estimant que l’esprit de son père risquait d’être trahi.
Elle ne s’oppose pas à l’usage de ces textes, mais exige que le ton, le rythme, la fidélité à l’addiction soit respectée. Cette intervention provoque un débat. Jusqu’où peut-on contrôler l’héritage artistique d’un auteur disparu ? L’aspect financier de son patrimoine reste flou. Pierre des Proches n’a jamais été un homme d’argent.
Il n’a jamais lancé de produits dérivés, de collection de citations, ni participer à des tournées lucratives. À sa mort, ses revenus provenaient essentiellement de droits de diffusion et de vente de livres. Sa famille n’a pas cherché à rentabiliser à outrance cet héritage, ce qui renforce l’image d’un artiste intègre mais rend la transmission de son œuvre plus vulnérable.
En l’absence de fondation, de société de gestion ou de défense structurée, des proches appartient un peu à tout le monde et donc à personne. En 2024, quand un politicien récupère sa célèbre phrase sur le rire de tout, la famille se retrouve sans outil juridique clair pour interdire l’usage. Le Conseil d’État confirme que les citations isolées, tant qu’elles ne sont pas diffamatoires, ne peuvent être interdites.
Cela relance la question : “Faut-il créer un statut spécifique pour protéger l’œuvre satirique après la mort de l’auteur ?” La polémique ravive aussi des tensions au sein même des milieux artistiques. Certains comédiens admirateurs de des proches plaident pour un usage libre et public de son œuvre au nom de la diffusion culturelle. D’autres, au contraire, appellent à la sanctuarisation de ces mots pour éviter toute trahison.
Un compromis partiel émerge en 2025. Une version intégrale annotée de ses spectacles est publiée accompagnée d’une préface de sa fille qui rétablit les contextes. Ce livre devient un bestsellaire, preuve que le public reste profondément attaché à l’intégrité de son verbe. Ainsi, plus de 30 ans après sa disparition, Pierre des Proches ne laisse pas un héritage matériel, mais un capital moral immense, encore disputé, non pas en millions d’euros, mais en mots pesés au trébucher, en silences ironiques, en éclat de vérité. Un patrimoine fragile,
sans muraille, sans avocat, qui survit dans les mémoires et parfois dans les malentendus. Le 18 avril 1988, il est 10h passé quand Pierre Desprog rend son dernier souffle à l’hôpital du Krumelin Bicre. Aucun journaliste n’est là, aucun photographe. Son départ est presque clandestin.
Selon les proches, il aurait souri une dernière fois, mais aucun témoignage direct ne vient confirmer cette image poétique. Ce matin-là, seule sa femme, Hélène, est présente dans la chambre. Leur fille, Anne, alors adolescente, est tenue à distance. L’humoriste avait expressément demandé à vivre la maladie dans le silence et à mourir sans tumulte.
Une demande difficile à respecter tant son absence les vide. Pourtant, aucun faire part public n’est diffusé, aucune annonce dans la presse nationale. Le pays ne le sait pas encore, mais l’un de ses plus grands esprits vient de s’éteindre. Aucun service religieux, aucun cortège. En guise d’adieu, une bande sonore enregistrée par des proches lui-mêmes est diffusée dans une salle anonyme auprès de quelques amis triés sur le volet.
Il y dit, d’un ton faussement solennel, je suis désolé de vous déranger, surtout un lundi, c’est tout. Une pirhouette d’humour noir comme ultime révérence. Le silence qui suit est glacial. Certains éclatent de rire nerveusement, d’autres restent figés. Il ne voulait pas de fleurs, pas de discours. Il voulait disparaître sans éclat avec la même discrétion qu’il leur estit exigé durant sa maladie.
Pour des proches, même la mort devait être un acte littéraire. Les jours suivants, la presse écrite se contente de brèves entrefilets. À la télévision, aucun hommage immédiat n’est organisé. Les rares mentions évoquent un satiriste décédé à 48 ans des suites d’une longue maladie. Aucun mot sur sa révolution du langage, sur son empreinte dans la culture française.
Il faut attendre plus d’une semaine pour que France Interre consacre une émission spéciale à son œuvre. Mais le mal est fait. Une page s’est tournée sans que personne n’ose vraiment la lire à voix haute. Ce n’est que des années plus tard que les vidéos de ces spectacles sont rediffusées. Un public plus jeune découvre stupéfait un homme capable de dire l’indicible avec élégance.
Sa phrase culte on peut rire de tout mais pas avec tout le monde devient virale bien avant l’air des réseaux sociaux. Pourtant au moment de sa mort elle n’ecitait nulle part. Elle dormait dans un sketch comme oublié. Ce n’est que dans l’appricoup que Desproche devient prophète. Mais ce basculement postume ne peut effacer le fait qu’il est mort sans reconnaissance nationale.
Son enterrement tenu dans une stricte intimité reflète son refus absolu du patas. Pas de caméra, pas d’allocution, une poignée d’amis, quelques membres de la famille, une urne funéraire sobre. Le lieu de dispersion de ces cendres reste à connu du grand public conformément à ses dernières volontés.
Il n’aura même pas de tombe à son nom, pas d’épitf gravé. Il n’en voulait pas. Il disait souvent “Si je meurs, laissez-moi tranquille.” On a obéi. Mais ce silence aujourd’hui raisonne comme un vide injuste. En 2025, lors d’un colloque sur la liberté d’expression organisé à la Sorbonne, une chaise vide avec son nom est installée symboliquement au centre de la scène.
Aucun discours, juste une citation projetée sur grand écran. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. L’auditoire rit, certains pleurent. Il n’y avait ni cercueil, ni fleurs, ni foule ce jour-là. Mais pour la première fois, ans après, la France semblait enfin lui dire au revoir. Aujourd’hui, l’héritage de Pierre des Proches ne se mesure ni en statue, ni en rue à son nom.
Il se propage à travers les mots. Des mots gravés dans la mémoire collective, souvent cités mais rarement compris. Il ne laissa ni fortune, ni fondation, ni testament philosophiques, juste des textes. Des textes qui dérange, qui décape, qui résistent aux récupérations faciles. Pourtant, en 2024, son œuvre a failli être défigurée par une citation sortie de son contexte.
Cette polémique a réveillé un débat de fond. Peut-on manipuler les mots d’un mort pour servir une idéologie vivante ? Sa fille, Anne des Proches, continue de veiller sur cet héritage fragile, non pas pour en faire un mauselé, mais pour préserver l’esprit. Elle rappelle que son père ne voulait pas être idolâtré, seulement écouté avec lucidité.
Le grand public lui redécouvre aujourd’hui la subtilité d’un humour qui ne criait jamais mais frappait toujours juste. Dans une époque où la nuance se perd, des proches redevient essentielles. Alors chers téléspectateurs, faut-il légiférer pour protéger les artistes après leur mort ou bien leur mémoire appartient-elle au vent ? Et surtout, qui sera là demain pour défendre les mots quand ceux qui les ont écrits ne peuvent plus les reprendre ?