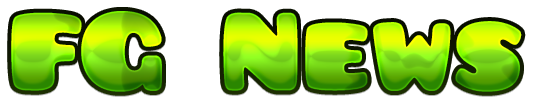Louis de Funesse. Rien que son nom évoque le rire, l’énergie, les grimaces inoubliables et ce rythme effrainé qui faisait de chaque scène un feu d’artifice comique. Mais derrière ce masque larant se cachait une vie marquée par la douleur, les épreuves et un combat permanent contre l’adversité. Né le juillet 1914 à Courbevois dans les Haut de scène, Louis de Funesse voit le jour au sein d’une famille espagnole exilée.
Ses parents, Carlos Louise de Funesse de Galarza et Léonore Soto Regra sont originaires respectivement de Séville et de Galice. Leur union désapprouvée par leur famille respective, les pousse à fuir l’Espagne pour chercher refuge en France en 1904. Là, leur rêve d’une vie meilleure va peu à peu s’éroder. Carlos, autrefois avocat et issu d’une lignée noble liée au compte de Galarza, ne parvient pas à maintenir son rang.
Il devient tailleur de diamant, un métier qui leur assure un semblant de stabilité jusqu’au jour où il se lance dans des aventures financières hasardeuses, espérant retrouver son prestige d’entend. Mais ses efforts échouent les uns après les autres. Ruiné, humilié, Carlos en vient à simuler sa propre mort. Il laisse un mot d’adieu, son chapeau et ses chaussures au bord d’un canal parisien.
En réalité, il s’enfuit en Amérique du Sud espérant un nouveau départ. Mais là-bas, ce n’est pas la fortune qu’il trouve, c’est la tuberculose. Il meurt seul, loin des siens. Louis n’a que quelques années quand il perd son père. Sa mère, Léonore, autrefois femme respectée d’un bon milieu, se retrouve subitement dans la misère.
Elle élève seule ses enfants dans un modeste appartement de courbe voie. Elle est fière, colérique, déterminée et cette force de caractère mêlée à ses explosions de colère façonnera à jamais le petit Louis. Selon le réalisateur George Lotner qui la connaissait personnellement, Léonore était célèbre pour ses colères théâtrales.
Elle tapait du pied, criait, poursuivait les gens dans la rue pour leur réclamer du crédit. une attitude aussi spectaculaire que gênante pour son jeune fils. Et pourtant, ce tempérament explosif, Louis le transformera plus tard en or comique. L’autur dira d’ailleurs le personnage de De Funesse, c’était sa mère. Dans cette pauvreté omniprésente, Louis développe un talent précieux.
Il découvre que faire rire les autres, c’est sa manière à lui de survivre. Quand sa mère crie dans les magasins, lui se cache, rougit, à honte. Mais dans le silence de sa chambre, il répète, il mime, il transforme la honte en comédie. Petit à petit, il façonne le clown qu’il deviendra. À l’école, pourtant, rien ne semble le prédestiner à une grande carrière.
Élève moyen au prestigieux lycée Condoret, il peine à se concentrer, abandonne ses études et perd tout espoir d’une voix traditionnelle. Sans diplôme, sans appui, il a de petit boulot en petit boulot. C’est alors que la musique devient son refuge. Louis joue du piano dans les bars de Pigal, au cœur de la nuit parisienne.
C’est là, au milieu des serveuses fatiguées et des clients distraits qu’il perfectionne son art du mime. Il joue, il grimace, il amuse. Son public est petit mais l’effet est là, les rires fusent. Le comédien est né. Connu sous le surnom affectueux de Foufou, Louis parle trois langues : français, espagnol et anglais et possède un don artistique indéniable.
Il aime dessiner, il aime jouer. Malgré ses échecs scolaires, il est habité d’une curiosité insatiable. Les club de jazz deviennent sa deuxième maison. Il y trouve l’opportunité de mêler sa musique à l’humour naissant qui boue en lui. Dans les années 1940, un tournant décisif, il s’inscrit à l’école de théâtre Simon.
Là, il côtoie de futurs grands noms du cinéma dont Daniel Géin, qui jouera un rôle crucial dans son avenir. Louis n’a pas le physique d’un premier rôle. petit le crâne dégarni l’allure quelconque et pourtant il brille. Son jeu physique, son regard expressif, son rythme est freiné. Il a quelque chose que les autres n’ont pas. Il se souvient plus tard de ce professeur de chimie qui le faisait hurler de rire à l’école simplement en prononçant le mot sodium hyposulphite.
Ce détail, ce souvenir d’enfance devient le symbole de sa comédie. Partir du quotidien pour en faire une scène inoubliable. Mais malgré son talent, le succès n’est pas immédiat. Louis enchaîne les petits rôles, souvent non crédités. Il est viré d’un travail à cause d’un incendie suspect. Il passe de l’école au chômage, du piano au rôle secondaire, de l’ombre à l’anonymat.
Son fils, Olivier de Funesse dira plus tard, “Mon père faisait toutes sortes de petits boulots.” Il n’en parlait jamais. Je crois qu’il embellissait un peu ses histoires. Louis lutte, son apparence l’éloigne des rôles principaux. Il persiste pourtant, il continue à jouer du piano dans les clubs, tout en montant sur scène pour des pièces mineures.
Le public commence à le remarquer. L’humoriste se forge. En septembre 1939, la guerre éclate. Louis est mobilisé. Son petit gabarit 1,65 m pour kg et ses antécédents familiaux de tuberculose l’écart du combat. Il est affecté à des tâches passives. Il divertit ses camarades, imite Maurice Chevalier. Organise de petits spectacles.
Une bouffée d’oxygène dans un monde à feu et à sang. Mais la tragédie n’est jamais loin. En mai 1940, son frère Charles est tué par l’armée allemande. Louis devient tuteur de son neveu Édouard. Même s’il est trop pauvre pour s’en occuper, cette perte le hante. Elle ajoute une nouvelle couche à la complexité de son humour, à la profondeur de son regard.
Pendant l’occupation, Louis enchaîne les métiers improbables. Cireur de chaussures, vitrier, gratteur de sol. Puis il revient à son refuge, le piano. Il joue dans des bistrop pour quelques pièces ou un simple café. Il charme les clients avec ses grimaces et ses mimiques. Il fait rire pour survivre. Le rire et son arme.
C’est dans ces années sombres qu’il rencontre Eddie Barkley, futur géant de la musique, qui se souvient de Louis comme un pianiste brillant incapable de lire une partition, mais doté d’une oreille exceptionnelle. Ensemble, ils s’inscrivent au conservatoire international de jazz. C’est là que Louis rencontre Jeanne Barteléemi, la femme qui deviendra sa compagne et le grand amour de sa vie.
En 1942, Louis décide de franchir le pas. Il a 28 ans. Il entre au cours Simon pour devenir acteur. Il passe l’examen avec une scène des fourberies de Scapin. Son destin joue. C’est là dans une rame de métro qu’il recroise Daniel Géin. Une simple phrase va tout changer. Appelle-moi demain, j’ai un petit rôle pour toi. La suite allait tout changer.
Les petits rôles s’enchaînent. Louis apparaît dans plus de 80 films sans jamais percer. Son nom reste absent des affiches. Ses personnages n’ont parfois même pas de nom, mais lui persévère. Il observe, il apprend, il pefine son jeu. Chaque apparition est une occasion de tester une nouvelle grimace, une nouvelle intonation, un nouveau rythme.
Et puis lentement, la machine s’emballe. Le public commence à le remarquer. Les réalisateurs aussi. Il n’est plus seulement un faire valoir, mais un comique redoutablement efficace. Son énergie débordante, son visage élastique et sa voix si particulière en font un ovni dans le paysage cinématographique français. En 1956, tout bascule.
Il décroche un rôle marquant dans la traversée de Paris au côté de Jean Gabin et Bourville. Même si son temps d’écran est limité, sa prestation fait mouche. Le public éclate de rire. Les critiques saluent ce petit bonhomme nerveux qui vole presque la vedette au géant. Pour la première fois, le nom de Louis de Funesse commence à circuler au-delà du cercle des initiés.
Mais c’est dans les années 60 que le phénomène explose vraiment. D’abord avec Pickpck en 1963 qui le révèle au grand public. Puis un an plus tard avec le premier volet d’une saga culte, le gendarme de Saint- Tropé. Le rôle de Ludovic Cruchot, gendarme autoritaire, maladroit et hystérique, devient emblématique. C’est un triomphe.
Le film pulvérise les records d’entrée. Louis de Funesse n’est plus un second rôle. Il est la star. Enfin, le succès est fulgurant, le public l’adore. Il est partout. Fantoma, le corno, la grande vadrouille, le tatoué, Oscar, Hibernatu. À chaque sortie, c’est une avalanche de rire, une salle comble, un triomphe.
Il devient le roi du boxoffice français, éclipsant même les plus grands noms du cinéma international. Et pourtant, malgré la gloire, Louis reste profondément marqué par ses années de galère. Il doute, il travaille d’arrache-pied, il répète inlassablement, il est perfectionniste, exigeant, parfois même tyrannique sur les plateaux. Il veut tout contrôler.
Les dialogues, les gestes, le montage. Ce n’est pas de l’orgueil, c’est de la peur. La peur de retomber dans l’oubli. Dans sa maison du Sélier, en Loire Atlantique, il vit reclu loin des mondanités. Il cultive son jardin, élève des roses, pain, lit. Il fuit les interviews, se méfie des journalistes. Loin des projecteurs, il redevient Louis, le discret, l’effacé.
Celui que le succès n’a jamais complètement rassuré. À la ville, il est l’opposé de ces personnages réservés, introverti, presque austère. Il n’aime pas les mondanités, déteste les fêtes, fuit les bains de foule. Il trouve son bonheur dans la simplicité. Un repas en famille, une promenade au bord de la Loire, un film de Charlie Chaplin.
Il est pudique, secret, insais, mais cette tension permanente, ce besoin de tout maîtriser finit par lui coûter cher. En 1975, alors qu’il est au sommet de sa gloire, il est victime d’une première crise cardiaque. Le choc est brutal. Les médecins lui imposent du repos. Les tournages s’arrêtent. La France retient son souffle.
Va-t-il revenir ? Contre toute attente, il revient affaibli, mais déterminé. Il tourne, l’aile ou la cuisse, en 1976 au côté de Coluche. Le succès est encore au rendez-vous, mais il sait que le compte à rebour est lancé. Son corps lui rappelle chaque jour qu’il n’est pas éternel. Il continue pourtant. La zizanie, l’avar, la soupe au chou, le gendarme et les gendarmettes.
Chaque film est un barou d’honneur, un dernier éclat de rire. Il donne tout ce qui lui reste. Il joue comme s’il allait mourir demain. Peut-être, le savait-il. En 1983, il reçoit enfin la reconnaissance officielle qu’il mérite. Il est décoré de la Légion d’honneur par le président François Mitteran. Une consécration tardive mais méritée.
Lui, le petit comique méprisé des débuts entre dans l’histoire de France. Mais le cœur de Louis est usé. Le 27 janvier 1983, il s’éteint à l’âge de 68 ans. Le pays tout entier est en deuil. Les journaux titresent : “La France a perdu son roi du rire”. Les hommages affluent. Les cinémas rediffusent ses films. Les rires raisonnent une dernière fois.
Louis de Funesse laisse derrière lui une œuvre immense. Plus de 140 films, des millions de spectateurs, des scènes cultes gravées dans la mémoire collective. Mais plus encore, il laisse un vide, un silence après le rire, un hommage au courage, à la ténacité, à la passion. Le destin d’un homme qui n’a jamais cessé de se battre pour exister, pour faire rire, pour vivre.
Aujourd’hui encore, plus de 40 ans après sa disparition, Louis de Funesse continue de faire rire des générations entières. Ses grimace, ses colères exagérées, son sens du rythme comique reste inégalé. À la télévision, ces films sont rediffusés inlassablement. Dans les écoles de théâtre, on étudie son art geste, sa précision millimétrée.
Sur internet, ces scènes cultes sont partagé par des millions de fans. Il n’a jamais eu besoin d’effets spéciaux ni de grandes cascades. Son corps, son visage, sa voix était ses seuls instruments et avec ça, il a conquis le monde. Il a su transformer ses faiblesses en force, ses doutes en énergie créative. Il a offert au public une comédie exigeante, sincère, généreuse.
Louis de Funesse, c’est plus qu’un acteur. C’est un monument, une légende, le rire incarné. Celui qui, d’un simple froncement de sourcil, pouvait déclencher une tempête d’éclat de rire. Et cela, personne ne l’a jamais égalé. M.