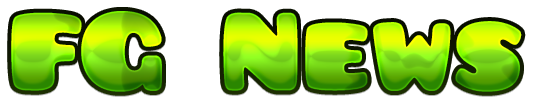Mesdames, messieurs, pendant des décennies, il a fait rire, réfléchir et frissonner des millions de lecteurs. Pourtant, aujourd’hui, dans les salons littéraires et les plateaux télévisés, son nom semble s’être évaporé. Frédéric d’art alias Saint-Antonio, est mort en 2000 dans un silence presque suspect, sans hommage national, sans cérémonie médiatisée.
Il avait vendu plus de 200 millions de livres, mais ses obsèques se sont déroulés à l’abri des caméras. Pire encore. Après sa mort, une bataille juridique a éclaté entre sa famille et son éditeur autour des droits de son œuvre. Comment expliquer que l’un des auteurs les plus prolifiques de la littérature française ait pu tomber dans l’oubli si rapidement ? Et surtout, qui possède réellement la langue San Antonio aujourd’hui ? Sa veu son fils ou un contrat signé à vie avec une maison d’édition ? Ce soir, nous allons revenir sur l’histoire incroyable d’un génie
populaire que la France a fini par cacher derrière ses propres mots. Frédéric Dard naî le 29 juin 1921 à Jalieux dans l’Iser. Son enfance est marquée par la pauvreté. Son père est ouvrier typographe. Sa mère suce dans des ménages. Très tôt, il se passionne pour l’écriture, gribouillant des histoires dont les marges de ses cahiers.
Il publie son premier roman en 1940, la peu chère, a seulement 19 ans. Mais le succès ne vient pas immédiatement. Il enchaîne les petits boulots, écrit des romans alimentaires sous pseudonyme tout en rêvant d’un style qui le rendrait unique. Ce style, il le trouve en 1949 avec la création d’un commissaire anticonformiste, drôle, violent, libidineux Saint-Antonio.
C’est un coup de tonner dans le paysage littéraire d’après-gerre. Loin des codes bourgeois de la littérature officielle, San Antonio parle comme les gens, invente des mots, casse les règles. Dar écrit avec frénésie 1 2 parfois trois romans par an. À partir des années 1960, il devient l’un des auteurs les plus lus de fense au coude à coude avec Simon ou Agatha Christi.
Mais cette popularité a un prix, la critique l’ignore, le méprise. Il est traité d’écrivain de gare, un homme qui noit le sens dans l’humour gras. Derrière le rythme effrainé, l’homme souffre. Il fait une tentative de suicide en 1965 après un drame familial. Sa fille adoptive est enlevée, violée, retrouvée morte. Cette tragédie ne sera jamais surmontée.
Il continue pourtant décrire comme pour fuir l’horreur. En 1981, il reçoit le Grand Prix de l’humour noir. Une reconnaissance marginale mais symbolique. À la fin de sa vie, il se retire en Suisse à Bonne Fontaine, vivant entre solitude et admiration de ses fans. Il commence à dicter ses romans affaiblis physiquement.
Son fils Patrice Dar commence alors à coécrire avec lui une transition qui ne sera pas sans conflit. Plus tard. À sa mort, il laisse derrière lui 175 volumes de San Antonio, plusieurs dizaines d’autres romans noirs sous pseudonyume et des milliers de pages qui font aujourd’hui partie du patrimoine linguistique français.
Pourtant, il reste encore largement absent des anthologies, des études, des institutions. Un oubli paradoxal pour celui qui a marqué la langue plus que bien des académiciens. L’appartement de Bonne Fontaine était plongé dans une étrange quiétude ceci juin 2000. Il n’y avait ni bruit de machine à écrire, ni éclat de rire provenant du bureau.
Frédéric Dart venait de s’éteindre à l’âge de 78 ans à la suite d’une longue maladie. Un cancer de l’intestin diagnostiquait plusieurs années auparavant qu’il avait caché à presque tout le monde à l’exception de ses proches. Il est mort dans son lit, entouré de sa femme et de son fils dans un silence à l’image de l’oubli progressif qu’il l’avait déjà frappé.
Aucun hommage national n’a été organisé. Aucune grande figure littéraire ne s’est exprimée. Les obsèques tenus à la cathédrale Saint-François de Salle à Lausanne ont été discrètes, presque confidentielle. Et pourtant, la nouvelle de sa disparition a provoqué une onde choc parmi ces millions de lecteurs fidèles qui ont déposé des fleurs devant les librairies.
Le président de la République de l’époque n’a pas fait de déclaration, ce qui a suscité l’indignation de plusieurs chroniqueurs littéraires dont François Busnel. La presse a relayé la nouvelle avec sobriété. Certains titres évoquant le dernier mot de San Antonio, d’autres préférant souligner la disparition d’un monstre sacré oublié des élites.
Mais le vrai tremblement de terre a commencé quelques semaines plus tard. La maison d’édition Fleuve Noir qui détenait les droits de publication des San Antonio depuis 1950 annonce vouloir poursuivre la série avec de nouveaux auteurs et principalement avec son fils Patrice d’art. Ce dernier accepte mais sous condition de contrôle éditorial total.
Très vite, un conflit s’installe. Plusieurs membres éloignés de la famille, ainsi que l’ancienne épouse de Frédéric d’art dénonce un accaparement du nom San Antonio. Des voix s’élèvent aussi dans le milieu littéraire pour dénoncer la poursuite de la série sans l’auteur d’origine, y voyant une trahison. Les tensions s’aggravent lorsqu’il est révélé que certains contrats de session de droit auraient été signés alors que D était déjà malade et dans un état de faiblesse psychologique.
La presse suisse évoque même une possible contestation post-mortème du testament, bien que celle-ci n’est jamais aboutie en justice. Sur le plan plus intime, plusieurs amis de l’auteur, dont l’humoriste Thierry Le Roulon et l’écrivain Michel Oddiard, tous deux aujourd’hui disparus, avaient exprimé leur inquiétude face à l’isolement croissant de Dart dans les années 1990.
Certains affirment qu’il avait perdu l’envie d’écrire. D’autres, au contraire, racontent qu’il dictait encore ses idées jusqu’à quelques jours avant sa mort. Le dernier roman publié de son vivant Turlut Gratos, ne s’est vendu qu’à une fraction des chiffres habituels comme un dernier souffle ignoré. Le mystère d’art ne tient donc pas seulement à sa mort physique, mais à sa disparition symbolique.
Comment un homme aussi lu a-t-il pu mourir dans l’indifférence des institutions qui décident de la légitimité d’un auteur ? Et surtout, peut-on vraiment faire mourir Sanon Tonio tant que quelqu’un quelque part continue à prononcer son nom ? À la mort de Frédéric Dart, la question de son patrimoine ne s’est pas limitée à une simple évaluation financière.
Officiellement, sa fortune personnelle était estimée à environ 5 millions d’euros principalement constitué de revenus de droits d’auteur accumulé sur plusieurs décennies de publications à succès. Il possédait une maison à Bonne Fontaine en Suisse où il s’était installé pour échapper au tumulte parisien et à la fiscalité française.
Cette demeure, aujourd’hui toujours en possession de la famille fait partie des biens qui ont suscité l’attention des médias lors de la succession. Mais le véritable enjeu patrimonial résidait ailleurs dans les droits d’auteur du catalogue Santonio qui représentait une mane éditoriel unique. Depuis les années 1950, Frédéric Dar avait signé plusieurs contrats à long terme avec les éditions Fleuve Noir.
Ces accords prévoyaient un partage des revenus mais aussi une exclusivité d’exploitation qui fut renouvelée à plusieurs reprises jusqu’aux années 1990. Après sa mort, ses droits sont revenus à sa veuve et à son fils Patrice d’art, ce dernier devenant le principal gestionnaire et continuateur officiel de la saga Santonio.
Il a publié plusieurs nouveaux volumes sous le nom de son père, parfois cigné, parfois écrit seul. Or, cette décision a immédiatement provoqué une onde choc. Des lecteurs historiques ont dénoncé une usurpation poste, arguant que le style unique de Frédéric d’art ne pouvait être imité. Plusieurs écrivains dont Jean-Bernard Poui et Frédéric Beckbeder ont critiqué la poursuite industrielle de l’œuvre y voyant une dérive commerciale.
Pire encore, en 2002, une ex-assistante éditoriale a révélé dans l’Express que certains contrats de session de droit avaient été modifiés peu avant le décès de l’auteur à une période où il n’aurait plus été pleinement lucide. Cette révélation a mené à une enquête notariale mais sans qu’aucune procédure judiciaire ne soit officiellement ouverte.
En parallèle, un autre litige émerge, celui de l’exploitation audiovisuelle. Plusieurs projets d’adaptation télé ou cinéma de l’univers Santonio sont proposés dans les années 2000 mais échouent tous à cause de blocage juridique entre la famille et les ayant droits secondaires. En 2008, la société de production Gomont annonce un projet de film mais celui-ci est suspendu indéfiniment faute d’accord sur le scénario et la supervision artistique.
Aujourd’hui, les livres de Dark continuent d’être réédités mais de manière éparce. Le site officiel Santano géré par Patrice d’art reste actif mais la valorisation du patrimoine se fait dans une relative discrétion. Aucun musée, aucune fondation officielle n’a vu le jour. L’État français n’a jamais proposé de classement patrimonial de l’œuvre malgré les appels de plusieurs académiciens.
En somme, l’héritage de Frédéric d’art demeure éclaté, riche en potentiel mais fragilisé par les tensions familiales, les choix éditoriaux et un flux juridique persistant. Pendant des décennies, Frédéric d’art a incarné une forme d’intelligence populaire, celle qui fait mouche sans passer par les salons doré de l’élite littéraire.
Pourtant, à peine deux décennies après sa disparition, une question obsédante se pose. Comment un auteur qui a tant vendu, tant marqué la langue a-t-il pu devenir aussi invisible dans l’espace public ? Ce paradoxe soulève un malaise plus large, celui du mépris persistant envers la culture dite de masse dans les cercles intellectuels français.
D avec son humour provoquant, ses tournures argotiques et sa tendresse pour les marginaux ne cadrait pas avec les normes esthétiques académiques. Il dérangeait. Et dans un pays où l’institution littéraire sacralise certains noms tout en reléguant d’autres aux étales de gare, le silence qui a suivi sa mort ressemble à un enterrement idéologique.
Ce phénomène n’est pas propre à Dart. D’autres figures populaires Claude François dans la chanson Jean-Pierre Moky au cinéma ont connu cette même forme de rejet après leur décès. Mais dans le cas de Dart, la blessure est double. Non seulement l’auteur est oublié, mais sa voix les réappropriée par d’autres.
Son fils Patrice a repris la plume sous le pseudonyme San Antonio, perpétuant l’univers sans jamais retrouver l’impact ni la reconnaissance. Cela pose une question éthique majeure. Peut-on prolonger une œuvre sans trahir l’esprit de son créateur ? Et surtout, le public est-il complice de cet effacement en acceptant des substituts sans révolte ? À cela s’ajoute le rôle des médias.
Pas de série documentaire, pas de vraie redécouvertes critique. Comme si sa prolité, plus de 170 romans, l’avaient discrédité. Trop d’humour, trop de sexe, trop de tout. Pourtant, les lecteurs n’ont pas oublié. Sur les forums en ligne, dans les brocantes, les volumes de Saint-Antonio circulent encore, chuchoté comme des plaisirs coupables.
La transmission passe de main en main en dehors des institutions. En définitive, l’histoire de Frédéric d’art interroge la mémoire collective. Qui décide de la valeur d’un écrivain ? Le succès populaire suffit-il à survivre à l’épreuve du temps ou faut-il pour entrer dans la postérité officielle se faire adouber par l’élite ? Peut-être qu’un jour la France fera de dard ce qu’il fut vraiment un auteur majeur de son siècle qui n’écrivait pas pour les juris littéraires mais pour le peuple.
Frédéric d’art repose aujourd’hui dans le cimetière de Bonne Fontaine loin des projecteurs, loin des plateaux littéraires qu’il n’a jamais fréquenté. Ces mots eux continuent de raisonner dans les marges, dans les lectures clandestines, dans les éclatrir solitaires. Il n’a jamais eu besoin de statu, de médaille ou de préface savante.
Il écrivait pour ceux qu’on oublie avec la langue de la rue, le souffle des tripes. Et pourtant, c’est lui qu’on a fini par oublier. Peut-être parce qu’il était trop libre, trop drôle, trop vivant. Peut-être parce que comme ces héros, il ne demandait rien. Mais chers téléspectateurs, souvenez-vous, derrière chaque roman de gare, il peut y avoir un monument de littérature.
Alors, qui décide de ce qui vaut d’être transmis ? Et vous, vous souvenez-vous encore de qui il était ?