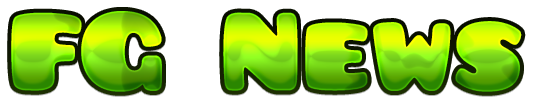yeux pour vous le jour du vran. Mesdames, messieurs, il avait survécu aux prisons nazi, défi la guéchappeau, risquer sa vie à 17 ans pour la liberté et pourtant il est mort dans un silence presque total. Le 21 septembre 2025, Léon Landini s’éteint à l’âge de 99 ans. Aucun hommage national, aucune mention dans les grands journaux télévisés.
ancien résistant FTP MOI, figure de la lutte armée contre l’occupation, il n’a jamais renié ses convictions, même lorsque la France officielle s’en est détournée. Il avait tout donné sans jamais rien réclamer. Pas de fortune, pas de pouvoir, pas de carrière politique tapageuse. Alors, pourquoi l’a-t-on oublié ? Était-il trop rouge pour les cérémonies républicaines, trop fidèle à un idéal qu’on ne veut plus nommer ? Alors que d’autres accèdent au Panthéon, lui s’efface seul dans l’ombre de l’histoire. Ce soir, nous vous
racontons l’ vie d’un homme que la République n’a pas su honorer. Léon Landini voit le jour le 9 avril 1926 à Saint-Raphaël dans le département du Var. Il est le fils d’Aristide Landini, immigré italien ayant fuit le régime fasciste de Moussolini pour trouver refuge en France. Dès l’enfance, Léon est imprégné d’un fort héritage politique.
Dans sa famille, on parle lutte, engagement, exil et justice sociale. Ce contexte forge en lui une conscience politique aigue. Lorsque la guerre éclate, il n’a que 14 ans. 2 ans plus tard, en 1942, alors que la France est occupée, il s’engage dans la résistance, rejoignant le Front National de lutte pour la libération de la France lié au Parti communiste français.
Il intègre ensuite les FTP MOI, un réseau de résistants armés essentiellement composé d’immigrés dont beaucoup comme lui ont fu les régimes autoritaires pour trouver la liberté en France. À Lyon et dans le sud du pays, il prend part à de nombreuses actions de sabotage. Attaque contre des lignes ferroviaires, destruction de dépôts allemands, embuscades contre les troupes nazis.
Il est encore adolescent mais agit avec une détermination que beaucoup de combattants chevronés lui enviaient. Il est traqué, repéré, arrêté en 1944 par la Guestapo et interné à la sinistre prison Mont-Luc à Lyon. Là, il subit de longues séances de torture, mais ne parle pas. Il survivra à l’enfer. Le 24 août 1944, à la faveur de l’insurrection de ville urbane, il parvient à s’évader avec d’autres détenus.
Cet épisode héroïque, le Marcavi. Il est par la suite décoré de la médaille de la résistance française, reçoit plusieurs distinctions internationale et sera faite officier de la Légion d’honneur en 1998. Après la guerre, Landini ne cherche ni reconnaissance publique ni carrière politique. Il se retire dans une vie simple et travaille comme exploitant forestier.
Il s’installe à Mont-Rouge où il s’implique également dans la restauration collective, un domine modeste mais essentiel à la vie sociale. Ce choix de vie étonne, presque des tonnes. Lui, le héros de la résistance refuse les carrières médiatiques, les honneurs politiques ou les postes électifs. Il consacre sa vie à transmettre la mémoire de la résistance, mais toujours selon ses propres termes, sans compromission.
Profondément attaché aux valeurs du communisme révolutionnaire, il reste membre du parti communiste français jusqu’à ce qu’il dénonce sa dérive idéologique. À ses yeux, le PCF a trahi ses racines, s’étant embourgeoisé et dilué dans les institutions. En 2004, à l’âge de 78 ans, il fonde avec d’autres camarades le PRCF, pôle de Renaissance communiste en France.
Un mouvement sans compromis opposé à ce qu’il considère comme la soumission de la gauche aux logiques libérales. Landini écrit, parle, se déplace pour porter cette voie minoritaire. Il participe à des conférences, rédige des tribunes, intervient dans des cercles militants et scolaires. Son discours est ferme, exigeant, frontal.
Il critique sans détour les élites politiques, y compris celles qui se réclament de son propre camp. Jusqu’à un âge avancé, il continue de témoigner notamment auprès des jeunes dans les lycées et universités. Il n’hésite pas à affronter les polémiques dénonçant ce qu’il appelle la falsification de l’histoire de la résistance, l’occultation du rôle des FTP MOI et des résistants issus de l’immigration.
Pour lui, l’histoire officielle a gommé trop de visages. Il entend les faire revivre. Mais dans une société qui préfère les récits consensuels aux vérités dérangeantes, Léon Landini reste à la marge comme s’il était devenu un témoin de trop. Le septembre, Léon Landini meurt dans son sommeil à l’âge de 99 ans dans son appartement de Montrouge.
Ce matin-là, c’est l’aide Soan qui le découvre inanumé, allongée sur son lit dans un calme presque solennel. La télévision est restée allumée toute la nuit. Sur la table de Chevet, une pile de journaux militants, quelques livres d’histoire et une lettre non envoyée. L’acte de décès mentionne une insuffisance cardiaque liée à l’âge. Il n’y avait aucun traitement en cours, aucune hospitalisation récente.
Il s’est éteint discrètement comme il avait vécu ces dernières années. Mais ce n’est pas la manière dont il est mort qui interroge. C’est l’écho ou plutôt l’absence d’écho. À peine quelques lignes dans la presse locale. Aucun hommage dans les médias nationaux, aucune déclaration officielle, aucun ministre, aucun député, aucun maire de grande ville ne prend la parole.
À l’Assemblée, pas une minute de silence. Sur les chaînes d’information, pas une image. Même le parti communiste français dont il avait été membre durant des décennies avant de s’en éloigner ne publie qu’un message sec sans profondeur. Le contraste est saisissant avec d’autres figures résistantes. Dès qu’un ancien compagnon de Manouchian disparaît, on s’empresse d’organiser des cérémonies, d’invoquer la mémoire, de panthéoniser.
Pourquoi cet effacement ? Plusieurs anciens camarades du PRCF, le mouvement qu’il avait cofondé, y voit une mise à l’écart délibérée. Pour eux, Landini a été jugé trop clivant, trop fidèle à une ligne politique dérangeante pour être récupéré dans le récit républicain consensuel. Il n’a jamais renoncé à sa critique radicale de la gauche institutionnelle, dénonçant sans relâche le réformisme, la trahison des idéos révolutionnaire et la récupération opportuniste de la mémoire résistante.
En 2014 déjà, il avait déclaré dans un entretien “Ils veulent des héros morts, inoffensifs, pas des témoins vivants qui parlent trop fort.” Ces dernières années, pourtant marqué par la fatigue et les douleurs physiques, sont restées actives. Il continuait d’écrire, de signer des tribunes, de répondre aux sollicitations.
Il ne voulait pas qu’on le pleure, mais qu’on écoute ce qu’il avait encore à dire. Quelques jours avant sa mort, il avait rédigé une lettre ouverte retrouvée sur son bureau dans laquelle il s’insurgeait contre l’hypocrisie des cérémonies officiel. Il y rappelait que la mémoire des FTP MOI avait longtemps été méprisée car trop communiste, trop étrangère, trop militante.
En l’absence de mage public, une cérémonie discrète est organisée par ses compagnons de lutte. Une salle prêtée par une mairie d’arrondissement. Une centaine de personnes, ancien résistants, militants communistes, lycéens, quelques proches. On y lit des extraits de ces discours. On chante le chant des partisans.
On partage des souvenirs. C’est sobre, sincère, sans drapeau tricolore. Il n’y a pas de caméra, pas de médias. À la fin, une jeune militante lit à voix haute une phrase qu’il répétait souvent : “On ne meurt pas quand il reste quelqu’un pour transmettre. Léon Landini n’avait pas peur de la mort.
Il avait déjà frôé la faim à 18x ans dans une cellule humide de Montluc. Ce qu’il redoutait, c’était l’oubli. Et ce jour de septembre 2025, c’est bien cela qui s’est produit. Une mort sans fracas, sans hommage national, sans reconnaissance tardive. Juste une porte qui se ferme doucement et une voix parmi tant d’autres qui s’éteint dans le silence.
À sa mort, Léon Landini ne laisse derrière lui ni fortune colossale, ni entreprise florissantes, ni propriétés spectaculaire. Il habitait depuis plusieurs décennies un appartement modeste à Montrouge situé dans un immeuble ancien à l’ombre des grands boulevards. Le logement loué via un bail à loyer encadré ne faisait pas partie d’un patrimoine immobilier personnel.
Aucun compte offshore, aucun placement financier d’envergure n’a été découvert. Contrairement à de nombreuses personnalités publique, Landini ne possédait ni droits d’auteur significatif ni œuvre publiées à large échelle susceptible de générer des revenus postumes. L’inventaire successoral transmis aux notaires de famille ne comporte que quelques biens mobiliers.
Une bibliothèque bien fournie en ouvrage d’histoire, de politique et de philosophie marxiste. Des documents personnels sur la résistance dont certains inédits, des décorations militaires, des lettres échangées avec d’anciens compagnons de lutte. Ces archives ont une valeur symbolique inestimable mais peu de poids économique.
Elles ont été confiées par ces héritiers à une association mémorielle engagée dans la transmission de l’histoire des FTP MOI. Certaines lettres pourraient, selon des chercheurs, alimenter de futures publications, mais aucun projet éditorial n’a encore été annoncé. Sur le plan des revenus, Landini bénéficiait d’une pension de résistants cumulé à une retraite modeste d’exploitants forestiers.
Aucun poste dans l’administration ou en politique ne lui ayant été attribué après guerre. Il n’a jamais touché d’indemnité lié à des fonctions publiques. Il avait refusé à plusieurs reprises des propositions d’intégrer des comités nationaux de commémoration dénonçant ce qu’il appelait une institutionnalisation de façade de la mémoire.
Concernant ses héritiers directs, il laisse derrière lui deux enfants aujourd’hui retraités qui ont choisi de ne pas engager de procédures particulières autour de sa succession. Aucun conflit n’est mentionné dans les registres notariaux. Les enfants, selon un communiqué transmis au PRF, respectent le choix de vie et d’engagement de leur père et n’envisage pas de tirer bénéfices matériel de son héritage.
Une partie des objets personnels a été conservée dans un local de l’organisation dans l’idée d’une future exposition dédiée aux résistants oubliés. En revanche, une tension a vu le jour autour de l’absence de reconnaissance publique. Plusieurs collectifs militants ont interpellé le ministère de la culture afin de réclamer qu’une plaque commémorative soit posée sur l’immeuble de Montrouge où il a vécu.
À ce jour, aucune réponse officielle n’a été apportée. Une pétition en ligne lancée par des enseignants d’histoire circule pour demander que les archives personnels de Landini soient classé au titre des archives nationales. Là encore, la démarche est en attente. Le paradoxe est saisissant. Cet homme dont l’engagement a façonné une part de l’histoire de la résistance meurt sans fortune, sans transmission patrimoniale tangible, mais avec une trace mémorielle profonde.
Si la loi ne reconnaît que des successions matérielles, la postérité, elle pourrait bientôt revisiter cette autre forme d’héritage, celle qui ne s’évalue pas en euros, mais en mémoire transmise. Dans les dernières années de sa vie, Léon Landini s’était progressivement retiré des engagements publics tout en restant en contact étroit avec les cercles militant du PRCF.
À plus de 95 ans, il ne participait plus aux manifestations mais continuait de signer des tribunes, d’échanger des lettres et de recevoir chez lui de jeunes militants venus écouter son témoignage. Selon l’un d’eux, il avait l’habitude de dire “J’ai vu mourir mes frères d’armes, moi je reste pour rappeler leur nom.
Ce rôle de passeur de mémoire était devenu sa raison de vivre. Le 20 septembre 2025, à la veille de sa mort, rien ne laisse présager une dégradation de son état. L’infirmière le trouve affaiblie mais lucide. Il parle encore avec vigueur des élections à venir, commente un article sur la montée de l’extrême droite en Europe et corrige un texte destiné à une revue militante.
Sur sa table, plusieurs ouvrages à notés : un recueil sur la résistance juive en France, une biographie de Manouian et un carnet de notes sur lequel il avait écrit en capitale pas de mémoire sélective dans la soirée. Il dent seul. Une soupe légère, un morceau de pain, un yaourt. Il regarde une rediffusion d’un documentaire sur la libération de Lyon.
À 22h, il téléphone à un ancien camarade de lutte, aujourd’hui installé à Marseille. La conversation est brève mais chaleureuse. Je suis fatigué mais je suis là. Tiens bon camarade, sont ces derniers mots connus. Le lendemain matin, le 21 septembre à 7h45, son infirmière entre dans l’appartement.
Elle trouve la porte entrouverte. Comme toujours et l’appartement baigné d’un silence inhabituel. Dans la chambre, Landini repose dans son lit, les mains posées sur le ventre, le regard fermé. Sur sa table de chevé, un vieux transistor diffuse à Baomume l’international, sans doute réglé en boucle sur une playlist militante. Le médecin, appelé immédiatement constate le décès peu après 8h10.
Aucune souffrance apparente. Le corps est intact, paisible. La fin d’un homme en paix avec sa vie. Les proches sont avertis discrètement. Il n’y a pas de communication officielle immédiate. Le père CF décide d’attendre 48 heures pour rédiger un hommage digne. En attendant, les messages s’échangent en privé entre ceux qui ont connu Landini et ceux qui ont croisé son chemin.
Un ancien enseignant écrit : “Il n’a jamais été célèbre, mais il a forgé des consciences.” Le 24 septembre, une cérémonie d’adieux est organisée dans une petite salle associative du 14e arrondissement. Une centaine de personnes sont présentes. Pas de drapeau officiel, mais des pancartes faites à la main. Résistance en compromis, FTP MOI, on n’oublie pas.
Les prises de paroles s’enchaînent. sobre mais bouleversante. Certains évoquent ses blessures physiques, ses silences entrecoupés de récits bouleversants. D’autres parlent de sa solitude mais aussi de sa dignité. Au moment de clore la cérémonie, une jeune lycéenne lit un extrait d’un discours que Landini avait prononcé en 2017.
Résister, ce n’est pas un acte du passé, c’est une exigence quotidienne. L’émotion est palpable. Ce jour-là, il n’y a pas eu de funéraill d’état ni de minutes de silence dans l’hémicycle. Mais dans cette salle anonyme, une génération de citoyens a dit adieu à un homme dont le dernier souffle a porté le poids de tout un siècle.
Il ne laisse ni héritage financier, ni villa à transmettre, ni fondation à son nom. Et pourtant, Léonlandini lue bien quelque chose. Une mémoire farouche, une ligne de conduite inaltérable, un témoignage d’engagement sans compromis. En refusant les honneurs opportunistes, en demeurant fidèle à ses idées, il transmet aux générations futures une forme rare d’intégrité.
Sa mort en silence, loin des projecteurs, interroge notre rapport collectif au héros discret. Fallait-il qu’il soit moins gênant pour être célébré ? Dans les jours qui suivent son décès, les hommages affluent dans les milieux militants. Des professeurs d’histoire, des lycéens, des anonymes partage ses textes, ses vidéos, ses entretiens rares.
Une forme de réhabilitation lente, presque souterraine, commence. Peut-être que sa mémoine ne sera jamais institutionnelle, mais elle vivra dans les marges, là où il a toujours existé. À ceux qui l’ont connu, il reste une voix grave, une main qui tremblait mais tenait toujours le drapeau de ses convictions.
Il n’a pas cherché à convaincre les puissants, mais à réveiller les consciences. Et c’est peut-être cela au fond le plus grand des héritages, avoir tenu bon là où tant d’autres se